Le poids d’une sculpture légère
Le poids d’une sculpture légère
« Toute ma vie de sculpteur j’ai recherché la légèreté, aujourd’hui j’ai envie de densité. » Attentif à la bonne réception de son propos, Philippe Gourier parle de sa sculpture avec une jubilation évidente. Par touches, par traits, classant au passage quelques items, il s’élance, déplie les procédures, revient sur une question matérielle ou technique, reprend l’idée ailleurs. Faisons l’hypothèse que c’est un peu sur un tel mode que s’est mise en place sa démarche de sculpteur. Une démarche impure, légère. Lui, veillant à ne pas alourdir le pas par trop de théorie au devant.
J’ai envie de densité, joignant le geste à la parole, il soupèse dans la main l’une des petites sculptures en acier posées devant nous sur la table. Un geste contagieux. Devant ces sculptures, nous éprouvons le désir immédiat de les peser, soupeser, de les retourner dans la main qui les tient facilement. Surpris par leur poids au regard de l’impression de légèreté, nous expérimentons que toute pesée donne à penser.
Aujourd’hui, j’ai envie de densité, aujourd’hui n’étant pas exactement semblable à hier, aujourd’hui s’articulant à hier, un moment, une charnière dans le déroulement de l’œuvre.
« Je dessine et je découpe. C’est nouveau pour moi, le dessin. » Il s’installe devant son ordinateur pour montrer de quelle manière le dessin est venu. Les pièces sont dessinées par l’intermédiaire d’un logiciel (rhinocéros) qui représente les volumes, les fait tourner dans tous les sens, exécute les calculs ardus d’intersection de certaines pièces. Du dessin à l’ordinateur au carnet à dessin il n’y a qu’un pas. Un étrange pas à rebours quand l’usage voudrait que les artistes passent d’abord par l’expérience de la main pour aller ensuite vers la virtualité de l’écran. Si l’image à l’écran, dans sa virtualité, n’est ni lourde ni légère, celle qui apparaît sur la feuille de papier, par la fragilité du support, la sensibilité du tracé au crayon, semble toute de légèreté. Pour lui dont la pratique se fonde sur la manipulation de la feuille d’acier, en venir tout à coup à la feuille de papier est une source d’étonnement. Pour nous, qui avons retenu qu’il recherchait le poids, nous pensons finalement, est-ce le poids ou la légèreté qu’il cherche ? Et cette question restera en suspens comme si, dans le flux de la parole vivante, simultanément à la venue de cette pensée, nous percevions que nous ferions erreur à vouloir traquer la contradiction. Chez Philippe Gourier entre la légèreté et le poids, il semblerait qu’il n’y ait pas d’opposition.
Il feuillette quelques carnets sur lesquels il a dessiné des figures, des détails. Si le dessin peut-être technique, il est aussi ailleurs, au-delà du technique. Le dessin, que nous pourrions écrire aussi dessein, constitue une bibliothèque d’images, un réservoir d’idées. Un besoin d’images pour nourrir l’imaginaire. Toute une poétique de l’emboîtement et du détail. Le dé-tail cette première découpe.
« Les découpages, c’est depuis avril 2007 qu’ils sont venus. L’idée c’était de jouer dans l’espace, découper à plat dans les plaques d’acier, que les plans prennent leur envol et que cela tienne ! » Plus c’est concret plus c’est parlant les explications d’un sculpteur.
« Au départ, il y avait les papiers découpés de Matisse. » Lui, découpe au plasma dans une feuille d’acier, c’est ainsi que Philippe Gourier fait son Matisse. Et les idées vont se suivre. Depuis un an une soixantaine de pièces qui appellent d’autres idées, qui en appellent d’autres, etc. Un moment heureux. Pas de censure, mais le plaisir de se saisir de ce qui arrive au moment où ça arrive.
« La légèreté, le poids, finalement c’est pareil », et il rit de découvrir qu’en formulant ce qui semble une incohérence, il touche là à une vérité profonde. A savoir, la densité d’une sculpture légère. Dans le clair-obscur de la pensée, les rapports entre le sens poids / léger, se retournent comme un gant, comme sur le bord de la courbe d’une sculpture de Richard Serra, quand c’est là, à la limite, que le poids se renverse pour devenir léger. Gageons que l’aujourd’hui dont parle Philippe Gourier est un moment charnière dans son œuvre, ce moment où, à la limite, le poids touche à la légèreté à moins que ce ne soit la légèreté qui touche au poids.
Gris et rouille, deux couleurs partagent les petites sculptures : gris, lié à la qualité de la surface de l’acier, lisse, liquide, luisant. Et rouille, la couleur offerte par les passages successifs de la pluie sur la plaque d’acier, gouachant la surface en flaques, en auréoles ou points. Des couleurs-matières dont le sculpteur-peintre arrêtera l’évolution infinie par un vernis.
Des petites sculptures bicolores et le vide. Par le dessin des éléments découpés dans la plaque d’acier, par le jeu de leur disposition, de leur orientation et de leur couleur, par la recherche d’un équilibre, par la relation entre les éléments, s’instaure la dialectique du volume et du vide. A travers les petites sculptures, ça circule, ça respire.
Quand nous croyons reconnaître comme des sortes de paysages émergeant de notre face à face avec elles, nous tentons une question. Non, paysage ne lui dit rien, visiblement, ce serait dépasser son propos, autant dire le manquer. Est-ce parce que paysage ferait référence à trop de représentation ? Géographie peut-être. Avec géographie, il y a le terrain, le sous terrain, le relief, le climat, etc. Pas de représentation, donc. Ah si ! Une fois un bonhomme, celui de l’image publicitaire ventant les qualités de l’apéritif Saint Raphaël, mixée à celle qui affichait Nectar et Glouglou, livreurs chez un célèbre marchand de vin. La réminiscence lui est tombée dessus, automatique. L’anecdote assumée, le bonhomme débarque en une profusion de livreurs, assemblés les uns aux autres, constituant une sculpture demi cylindrique que nous appellerons en toute désinvolture, la planète du sculpteur. Petit personnage d’un autre temps, cavalant sous la figure de ces livreurs pressés, empressés de nous livrer l’ivresse. Réminiscence d’un sculpteur épicurien, dont « la main réfléchit plus vite que le cerveau. »
Il prend une petite sculpture sur la table, la démonte, la remonte, « ça s’emboite, ça tient comme ça ». Philippe Gourier peut aussi désassembler certaines de ses sculptures, comme on défait un casse-tête chinois : « celle-ci est démontable» dit-il, tirant la clavette, la petite pièce d’acier dont le rôle est le même que celui de la cheville dans les ouvrages en bois : la pièce qui bloque. Avec une autre, il tâtonne pour replacer dans le creux qui doit l’épouser une figure à la découpe singulière, comme on le fait avec ces jeux en bois dans lesquels les figures chat, poules, etc, s’emboitent dans leur creux respectif. Mais ici, l’acier pèse dans la main. Avec une autre encore ça pivote, c’est la même plaque qui s’ouvre, qui se découpe comme une porte ou une fenêtre. Au cours de la recherche de leur emboîtement, ou de leur point d’équilibre, au moment de leur assemblage ou de leur démontage, le poids des figures donne au toucher une sensation singulière. A l’impression de légèreté des figures, produite par le dessin, la découpe, la disposition dans l’espace, s’ajoute cette sensation de poids.
« Mon souci c’était de transformer la frontalité. » Ce n’est pas le blanc souci de la toile, — celui du peintre vu par le poète (Mallarmé, « Salut », Poésies) — mais celui du sculpteur, souci du plan et de sa frontalité. Toute une variété de solutions comme autant d’ouvertures pour repartir dans l’espace. Et que cela tienne ! L’équilibre, un jeu d’enfant.
« Ça venait comme ça venait. » Accepter les moments heureux, ceux qui portent, « suivre la vague », comme on accepte aussi les moments d’assèchement. « Ne pas forcer l’allure ». Comme si le vide n’était pas seulement entre les pleins de la sculpture, mais aussi dans la démarche dont il faut articuler les grands pans. Alors, les moments creux (les vides), font charnière. Bon d’accord, les périodes fastes c’est plus agréable à vivre que les moments d’assèchement.
« La part picturale a toujours été très présente dans mon travail. » Dans les années 90-2000, il a réalisé une série de panneaux muraux. Présentés contre un mur, ces œuvres, sortes de tableaux reliefs qualifiés de « maniéristes » par le sculpteur, montrent bien la relation au toucher, la bella maniera, en opposition avec la règle d’imitation de la nature. A condition de ne pas entendre maniériste, dans le sens de chichiteux, la focalisation trop importante sur un détail, la préciosité de la réalisation, tout ce qui occulte la vision d’ensemble d’une pièce. Sans crainte de se contredire il ajoute : « je me suis toujours méfié du maniérisme et j’espère ne pas y être tombé.» Dans ses sculptures, ne pas chercher la course sans fin vers la perfection. L’attention portée à la réalisation ne se fait pas au détriment de la conception. Et si ces reliefs maniéristes (ou matiéristes) en appellent au toucher, par leur présentation en tableau, naturellement nous ne les touchions pas.
Mais aujourd’hui, posées, pesant sur leur support horizontal, appelant la main, prêtes à la caresse, avec les petites sculptures bicolores nous passons à l’acte. Attentif aux détails, le sculpteur en a poli les surfaces, adouci les arêtes dans l’attente des manipulations à venir. Une sculpture pour sa tactilité : « mes premières émotions allaient à Henri Moore, mais la pierre c’était pas pour moi. » Un tel choix se discute-t-il ? Nous en prenons bonne note comme à l’écoute de la parole de l’amoureux déclarant, cette femme n’est pas pour moi. Donc la pierre non, pour lui c’est l’acier. Il dira aussi, en guise d’explication que, pour autant que l’on puisse partager les sculpteurs en deux grandes familles, ceux qui retranchent et ceux qui ajoutent, il appartiendrait à la seconde famille. Nous nous souvenons alors des sculptures aux modules d’acier, les Tricots, réalisées dans les années 80-90, dans lesquelles, un module s’ajoute à un autre module. C’est alors, dans la répétition quasi-obsessionnelle, dans l’addition mille fois répétée que se construit la sculpture. Si avec la pierre la sculpture retranche, avec l’acier elle procède par ajout. Ce que la pierre refuse, l’acier l’autorise et dans l’inclinaison de Philippe Gourier pour l’acier, il y a la possibilité de cet ajout.
Et puis, vient la question du format : comment passer des petites sculptures aux grands formats, lui, ne voulant pas faire que des petites ? Nous, déjà attachés à elles, ces petites sculptures qui nous regardent. Sans intention anthropomorphique, elles sont pourtant nombreuses à avoir une face et un dos et il se pourrait que notre attachement passe aussi par cette expérience visuelle d’une sculpture qui nous regarde. Nous, regrettant déjà qu’il cherche ailleurs, à faire autre chose. Mais, nous tairons nos remarques de timorés, n’ignorant pas que l’aventure est là où le risque se prend. Explorer plus loin, bien sûr. Donc, pas de répétitions infinies, ou bien si, la répétition assumée quand le prolongement s’impose. « Avant je ne voulais pas me copier, aujourd’hui j’accepte de revisiter ». Pas de répétition donc, mais aller plus loin. Pas de censure mais revisiter.
« Le grand format, c’est autre chose, l’agrandissement littéral est impossible ». Avec les grandes sculptures, l’épaisseur des éléments devient problématique. Alors, il expérimente : deux plaques reliées par un chant maintenant un espace vide de quelques centimètres entre elles, fabriquant ainsi une épaisseur feinte. Le vide, dans ce cas là, est emprisonné dans l’épaisseur même des éléments de la sculpture. Le changement de format imposant d’autres solutions qui prolongent les variations. Il réalise aussi, la maquette (deux mètres de hauteur pour une sculpture qui doit en faire six) d’un projet de sculpture monumentale pour le plateau du Kirschberg. La sculpture monumentale, une vraie question : « ça ne se pense pas pareil ». La sculpture monumentale, celle qui se compte en mètres ne se pense pas de la même façon que celle qui se compte en centimètres. Pour nous, le rapport au corps diffère. Pour lui, « c’est une réinterprétation ». Tout est différent, les rapports de masse, les assemblages, les vides. C’est en partant des vides qu’il redessine la sculpture, des vides à réanimer.
Quand nous arrivons à l’atelier de Philippe Gourier, devant le rideau de fer qu’il relève à grand fracas de tôle, abandonnées dans la cour à même le seuil de l’atelier, nous retrouvons des petites figures plates en acier. Elles ont été découpées dans les grandes plaques et sont exposées là dans l’attente d’intempéries qui ne sauront tarder. On est à Roubaix, à proximité de Lille. L’abandon est ici volontaire, et que le ciel produise sur l’acier son œuvre de rouille!
« Découper, enlever les bavures, polir les surfaces, exposer à la pluie certaines figures, brosser, `positionner les éléments, souder, vernir ». En quelques mots, il balaye la chronologie des procédures : une succession de gestes qui disent les mains qui pensent. Une kyrielle de pièces est menée de front, simultanément les stades différents se côtoient et l’assemblage se réinvente à chaque étape. La découpe au plasma des figures dans la plaque sera plus ou moins fidèle au dessin prévu, — « ça dépend si je suis en forme ou non » — mais si d’aventure viennent des bavures, des accidents, il prend.
« Avec les grands formats, il s’agit d’occuper l’espace avec un moindre poids, je ne suis pas Richard Serra » dit-il, s’empressant d’ajouter, « mais je voudrais bien ». Donc, viser le démontable : c’est le rapport à la camionnette qui va déterminer le volume des éléments de la sculpture, et par là, nous le voyons faire confiance à la contrainte matérielle pour produire ses effets, assumer la dépendance aux contraintes matérielles jusque dans la démarche. « L’évolution de ma sculpture a été parallèle à l’acquisition d’outillage. » Ainsi son travail va-t-il se renouveler dans un univers d’espaces gigognes délimités par le champ ouvert à la suite de l’acquisition de chaque nouveau matériel d’importance. « Ces acquisitions ne doivent rien au hasard ni ne sont des caprices. » Le processus est souvent identique : à chaque nouvelle technique, un territoire s’ouvre qu’il convient d’explorer; lorsque cette exploration s’épuise, le besoin d’autres territoires s’impose. Il cherche alors de nouvelles techniques à mettre en œuvre. Et c’est une nouvelle sphère de possibles qui s’ouvre, à explorer, etc.
Prise dans le temps qui passe, sous celui de la pluie qui tombe, le temps de rouille, la démarche de Philippe Gourier raconte des histoires de volumes et de vides, de structures et d’ordonnances, d’architectures. Autant de traits qui nous font penser à Chillida. Mais c’est sans doute par le rôle nouveau chez lui, dévolu au dessin que nous rapprochons son travail récent de celui du sculpteur Basque quand, du poids à la légèreté, ça va ça vient.
Pendant ce temps, Philippe Gourier se lance aussi dans un projet ambitieux de maison-atelier-lieu-d’exposition. Un lieu pour abriter à la fois, famille, amis, amateurs, artistes. Tous ensemble, mais à chacun son espace défini. Chez lui, comme en sculpture, ça prolifère pour autant que ça s’organise. Devant le chantier monumental de la maison, nous le voyons ici encore en veilleur de légèreté. Le passage de son atelier actuel et provisoire à la maison globale fera charnière. Un pas décisif vers, le vivre avec.
Anne Catoire
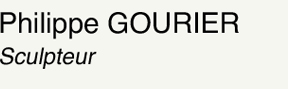
Les commentaires sont fermés.